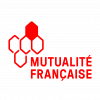Attaque contre le salaire différé financé par les cotisations sociales
Bruno Retailleau, président des Républicains, s’est illustré le 28 août par un discours on ne peut plus clair sur sa vision de ce qu’il appelle « les charges » sur le salaire.
Ce que, nous, nous définissons comme le salaire différé. Au-delà de 1 623 heures de travail par an, disparition complète de la cotisation salariale et patronale : telle est sa proposition.
Que signifie une telle mesure pour le financement de la Sécurité sociale, alors même que le Premier ministre affirme qu’elle serait « en faillite » ? Et quel est l’objectif idéologique de ce projet ?
Le principe fondateur de la Sécurité sociale
Le salaire différé est l’une des plus grandes conquêtes sociales arrachées par les travailleurs de ce pays, intégrée dans le programme du Conseil national de la Résistance en 1945 et concrétisée par la création de la Sécurité sociale.
C’est la solidarité organisée entre actifs et retraités (retraites par répartition), entre bien-portants et malades (assurance maladie), entre travailleurs et chômeurs (assurance chômage). Le principe est simple : les risques de la vie ne doivent pas être une fatalité laissée aux plus riches ou à la charité, mais relever d’un système pérenne, solidaire et universel.
Cotisations sociales : un salaire et non une charge
Pour cela, ont été mises en place les cotisations sociales, reposant sur le prélèvement d’un pourcentage du salaire. D’où la notion de « salaire différé » que l’on pourrait aussi définir par « revenu différé ».
Ces cotisations sont réparties en une part dite « salariale » et l’autre part dite « patronale ». Le patronat les dénonce depuis des décennies comme une « charge » insupportable. Pourtant, elles ne sont qu’une part du salaire socialisé : sans cotisation, elles reviendraient directement au salarié. C’est bien ce qu’illustre le discours de Bruno Retailleau lorsqu’il promet de « rapprocher le salaire brut du net ».
Des droits pour chaque assuré
Ces cotisations prélevées sur le salaire sont reversées aux régimes de Protection Sociale comme la Sécurité sociale, l’Assurance maladie, les régimes de retraite. Ces régimes ont une gestion de type « paritaire » plus ou moins indépendante de l’Etat. Le PLFSS (projet de loi de financement de la Sécurité sociale) est soumis au vote parlementaire. En revanche, le régime de retraite complémentaire des salariés du privé AGIRC-ARRCO a une gestion paritaire totalement indépendante de l’Etat.
Dans les deux cas de figure, les cotisations versées donnent des droits aux salariés.
Ce sont donc les travailleurs eux-mêmes qui financent et mutualisent leur protection sociale par le biais des confédérations syndicales qui les représentent au sein de conseils d’administration paritaires.
Ces derniers sont composés également de représentants du MEDEF au titre des cotisations « patronales ». La conséquence juridique de ce mode de financement par la cotisation sociale est essentielle puisqu’il génère des droits pour chaque assuré, au contraire de l’impôt.
Quand l’impôt se substitue aux cotisations
Depuis quarante ans, les gouvernements successifs, qui, manifestement, ont été sensibles aux arguments du MEDEF concernant le « poids énorme des charges patronales » - mais bizarrement sourds aux milliards d’euros d’aides aux entreprises ces dernières années (211 milliards en 2023) -, ont pourtant remplacé une partie des cotisations par des impôts déguisés comme la CSG et multiplié les exonérations : suppression de certaines cotisations AGIRC-ARRCO, disparition des cotisations salariales Assurance chômage en 2019, etc.
Résultat : aujourd’hui, plus de 50 % du financement des régimes sociaux repose sur l’État, et donc sur l’impôt.
Or, c’est bien la cotisation sociale qui donne des droits, eux-mêmes différés à des dates
déterminées par les réglementations en vigueur (remboursement maladie, conditions de départ à la retraite, etc.) alors que l’impôt, par nature, ne génère aucun droit.
Une remise en cause idéologique
Nous sommes loin, très loin de l’idée originelle qui a présidé à la création des régimes sociaux paritaires financés par la cotisation sociale au profit de tous, avec comme objectif la préservation de la santé, de la dignité de chacun dans un système vertueux basé sur une solidarité organisée par la cotisation sociale.
Ce qu’a proposé Bruno Retailleau, sous les applaudissements nourris du MEDEF, n’est que la continuité d’une vision « beveridgienne » de la protection sociale entièrement gérée a minima par l’Etat, laissant ainsi une place de choix aux compagnies d’assurances privées, contre une vision « bismarckienne » d’organisation paritaire : syndicats de salariés et organisations patronales.
C’est là l’aspect idéologique de cette proposition qui acterait la disparition des organisations syndicales libres et indépendantes au profit d’un syndicalisme d’accompagnement subsidiaire de l’Etat.
Le salaire différé : un choix de société
Le salaire différé n’est pas une option de gestion parmi d’autres. Il est l’expression la plus concrète de la solidarité entre travailleurs et de leur indépendance face aux risques de la vie. Il est aussi l’incarnation d’un syndicalisme libre, garant d’un système social fondé sur la dignité et la justice .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le salaire différé, c’est quoi ?
• Une partie du salaire mise en commun par les cotisations sociales.
• Un financement de la Sécurité sociale, de l’assurance maladie, du chômage et des retraites.
• Des droits concrets et différés : remboursement santé, pensions, indemnités.
• Contrairement à l’impôt, les cotisations garantissent des droits pérennes et précis.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Protection sociale parrainé par MNH
- Relations sociales