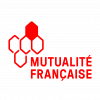Organisations
Loi travail : à qui profite le crime ?
Le projet de loi de la ministre portant sur la refonte du code du travail est, si l’on en croit nombre de ses détracteurs, sinon une dérégulation totale du droit du travail, du moins une remise en cause évidente de l’équilibre fragile des rapports sociaux dans l’entreprise, notamment par cette détermination affichée d’inverser la hiérarchie des normes régissant les relations professionnelles.
Cette inversion se caractériserait, si le projet de loi était voté, par le rôle central donné à l’entreprise dans la création de ses propres normes sociales indépendamment de celles édictées par la branche professionnelle dont elle relève et de celles élaborées par le législateur.
Ainsi rénové, le code du travail devrait, d’après ce projet, s’articuler autour de trois axes.
Pour autant, avant de comprendre les raisons d’un tel acharnement contre le code du travail et d’identifier ces acteurs qui réclament ardemment le droit d’écrire leur propre permis de licencier, il convient au préalable de s’interroger sur deux points :
En encourageant ainsi les négociations au niveau de l’entreprise, le législateur veut, par cette loi, donner sens au principe constitutionnel de participation instauré par l’alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946 en rendant plus concret le droit des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leurs conditions d’emploi et de travail et de leurs garanties sociales.
Les lois de 1998 et 2000 portant sur l’ARTT accélèrent de manière importante les négociations d’entreprise. Plusieurs autres lois en abondent les règles et les contenus. Toutefois, c’est la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 qui modifie profondément les mécanismes de la négociation collective en altérant le principe de faveur qui fonde alors la hiérarchie des normes [2].
Elle réorganise, en effet, les rapports entre les conventions et accords collectifs conclus à des niveaux différents, en accordant davantage d’autonomie à la négociation d’entreprise ou d’établissement [3].
En outre, elle offre la possibilité à l’employeur de négocier des accords collectifs avec des élus du personnel (comité d’entreprise, délégués du personnel) en cas d’absence de délégués syndicaux, d’une part et d’autre part, définit des modalités de consultation directe des salariés, sous forme de référendum permettant la ratification de certains accords collectifs. C’est ce que l’on appelle dans le jargon administratif : les processus atypiques de négociation [4].
En France, la régulation sociale est un fait politique. Le législateur ne traduit, dans les textes, que la volonté politique de ceux qui gouvernent.
Aujourd’hui, par le développement, l’élargissement et la décentralisation de la négociation collective, l’intention politique vise à favoriser clairement la montée en puissance du contrat dans l’ordre juridique qui régit les relations professionnelles.
Les propos du ministre François Rebsamen, lors de son audition à la commission « croissance, activité et égalité des chances économiques » du 11 mars 2015 au Sénat sont, à ce titre, révélateurs d’une telle ambition : « le contrat de travail n’impose pas toujours un rapport de subordination entre l’employeur et le salarié. Il est signé entre deux personnes libres qui s’engagent mutuellement ».
Ainsi, si le projet est voté, la négociation collective d’entreprise ne se contentera plus d’adapter, de modifier voire d’effacer la loi.
Elle se posera en processus législatif principal se substituant au législateur pour définir la loi sociale, rendant, de fait, les salariés (encore plus) inégaux en droit.
À cet égard, l’article 1 issu du rapport Badinter chargé de définir des principes essentiels du droit du travail est le fondement d’une telle orientation. Cet article suggère que les libertés et droits fondamentaux de la personne (salariée ?) dans la relation de travail peuvent être limités par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise.
Rappelons que la caractérisation du « bon fonctionnement » de l’entreprise relève du pouvoir de direction. Et d’influence de l’employeur.
Mais les effets de la crise économique des années 1970, la levée des barrières douanières à l’intérieur de l’Europe, l’internationalisation des économies mais également (et surtout) les nouvelles idéologies managériales véhiculées par des gourous autoproclamés du management lui font prendre conscience de l’opportunité d’une telle orientation.
La négociation devient alors, pour une partie du patronat, un outil de gestion. La négociation ne doit plus se centrer sur le conflit d’intérêt, c’est-à-dire la recherche d’une maximisation des « gains » de chaque partie mais sur la conquête de nouveaux champs relevant auparavant de son pouvoir de gestion.
En impliquant ainsi les organisations syndicales dans les transformations de l’organisation, les modalités de gestions des ressources humaines voire la définition du volume d’emploi, les employeurs encouragés par le législateur transforment ipso facto la négociation collective en levier de flexibilisation.
Les entreprises tentent ainsi de produire des accords basés sur une logique d’adaptation, c’est-à-dire donnant-donnant (ex : maintien du volume d’emploi en contrepartie d’une diminution du nombre de RTT) leur permettant par la même occasion d’éviter la création de nouveaux acquis sociaux.
Pour autant, les entreprises sont-elles prêtes à s’inscrire dans une telle démarche, à savoir écrire leurs propres normes sociales ?
Qualitativement, et ce malgré la diversification des thèmes de négociation voulue par le législateur, les négociations d’entreprise restent principalement centrées sur les salaires (environ 33 % des accords en 2014), le temps de travail (environ 21 % des accords en 2014) et l’épargne salariale (environ 16 % des accords en 2014) [6].
Quantitativement, le taux d’accords d’entreprise signés au regard du nombre d’entreprises en capacité de signer des accords reste ridiculement faible, voire « epsilonesque ».
Pour l’année 2013, le ministère du Travail en recense quelque 36 500, dont 5 500 signés par des élus dans le cadre des processus atypiques de négociation.
Selon l’INSEE, le nombre d’entreprises s’élève, la même année, à quelque 3 752 544, dont 1 185 637 entreprises d’un salarié et plus.
Ainsi, seules 3 % des entreprises signent des accords collectifs [7].
Par quelle opération, les 97 % d’entreprises préférant jusqu’à présent s’en remettre à la loi s’empareraient subitement de l’occasion qui leur est donnée pour produire leur propre norme sociale ? D’autant que l’un des principaux freins qu’elles évoquent lorsqu’on les interroge est le risque juridique majeur qu’elles encourent en cas d’accord « mal ficelé ».
Qui sont donc ces dirigeants qui réclament la mise en place d’une telle disposition ?
Depuis le décret n° 2008-1354, pris en application de la loi de modernisation de l’économie, l’entreprise ne se détermine plus simplement selon des critères économiques ou juridiques. Elle se définit d’abord comme la plus petite combinaison d'unités légales (personnalité juridique morale ou physique) qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes.
Cette approche permet d’assimiler chaque groupe [8] à une entreprise.
Ainsi, les entreprises sont officiellement classées en quatre catégories de taille [9], en tenant compte non seulement des effectifs employés mais aussi du chiffre d’affaires et du total de bilan.
En 2011, on distingue ainsi (hors secteur agricole et hors administration) :
On comprend ainsi aisément que les GE, plus particulièrement celles qui ne relèvent pas des activités financières et d’assurances, ainsi que les ETI sous tutelle économique de leurs donneurs d’ordres, sont particulièrement intéressées par la place centrale que le législateur souhaite donner à la négociation d’entreprise.
À ce jour, leurs accords collectifs d’entreprises sont généralement plus favorables que les accords des branches dont elles dépendent. Or, la négociation collective autrefois considérée comme une contrainte est aujourd’hui (pour elles) un outil d’adaptation aux pressions concurrentielles devant leur permettre de revenir sur certains acquis sociaux.
La loi Warsmann du 22 mars 2012, puis l’ANI du 11 janvier 2013 et la loi du 14 juin 2013 n’autorisent les entreprises, en cas de difficultés économiques, de revenir que temporairement sur certains acquis sociaux (augmentation du temps de travail sans compensation salariale voire baisse des salaires) encadrant malgré tout les velléités de l’employeur. Le cas de l’entreprise Smart appartenant au groupe Daimler AG est à ce titre emblématique.
Pour autant, dans un contexte international de « shopping law » [12], elles estiment que le carcan législatif ainsi que le cadre conventionnel actuel restent des freins au développement de leur compétitivité et à la réalisation de leurs marges. Il convient donc de les refonder à leur avantage. Le code du travail reste le fléau n° 1 des patrons français, sic Pierre Gattaz [13] et des patrons dirigeant les 0,2 % des entreprises recensées.
Finalement, pour un nombre très limité d’entreprises, la production de leurs propres normes sociales devient un avantage stratégique et économique non négligeable qu’il convient de développer, quitte à l’imposer à l’ensemble des entreprises et des salariés.
Il est clair que la possibilité donnée aux accords d’entreprise de s’affranchir de l’édifice juridique actuel n’a d’autre ambition que celle de la diminution du coût du travail.
Dans un précédent article [14], j’avais souligné que la règlementation sociale n’était pas un frein au développement économique et social d’un pays comme d’une entreprise mais la cause en était bien l’évasion et l’optimisation fiscale et sociale. Elle représente quelque 6,7 % du PIB [15].
J’avais également mis en exergue la primauté de la distribution de dividendes au détriment de l’investissement productif et de la création d’emplois.
Ce projet de loi ne profitera, donc, ni à l’entreprise dans le cadre de la reconstitution de son appareil productif, ni aux salariés dans le cadre du maintien de leurs avantages acquis, ni à l’emploi dans le cadre de la lutte contre le chômage.
Il profitera à l'évidence aux actionnaires de ces entreprises.
[1] La loi n°82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail.
[2] Un contrat de travail ne pouvait recéler des clauses moins favorables que celles prévues par l’accord d’entreprises, qui elles-mêmes ne pouvaient être inférieure à celle de l’accord de branche, accord de branche qui ne pouvait être moins favorable aux salariés que la loi
[3] Ainsi, une convention ou un accord collectif d’entreprise peut déroger, y compris dans un sens moins favorable pour les salariés, aux dispositions d’une convention ou d’un accord conclu à un niveau supérieur (branche, professionnel, interprofessionnel), tant que l’accord de niveau supérieur ne l’a pas expressément exclu (CT art. L. 2253-3, al. 2). La dérogation reste proscrite dans certaines matières : salaires minima, classifications, protection sociale complémentaire et fonds de la formation professionnelle (C. trav., art. L. 2253-3, al. 1er).
[4] Cf articles L2232-21 à 23 du code du travail (réservés aux entreprises, de moins de 200 salariés, dépourvues de délégués syndicaux).
[5] Cf interview d’Yvon Chottard, vice-président du CNPF, dans Le Monde du 9 février 1982.
[6] Bilan de la négociation collective en 2014, DGT.
[7] 36 500 accords (dont 5 500 signés dans le cadre des processus atypiques) par rapport aux 1 185 637 entreprises (dont 1 177 867 entreprises de moins de 200 salariés).
[8] Selon l’INSEE, un groupe de sociétés est une entité économique formée par un ensemble de sociétés qui sont soit des sociétés contrôlées par une même société, soit cette société contrôlante. Contrôler une société, c'est avoir le pouvoir de nommer la majorité des dirigeants. Le contrôle d'une société A par une société B peut être direct (la société B est directement détentrice de la majorité des droits de vote au conseil d'administration de A) ou indirect (B a le contrôle de sociétés intermédiaires C, voire D, E, etc. à qui elle peut demander de voter d'une même façon au conseil d'administration de A, obtenant ainsi la majorité des droits).
[9] INSEE Focus n° 4, avril 2014.
[10] Une grande entreprise est une entreprise qui a au moins 5 000 salariés. Une ETI a entre 250 et 4 999 salariés. Les PME occupent moins de 250 personnes. Une micro-entreprise emploie moins de 10 personnes.
[11] Selon l’INSEE, les PME (y compris les micro-entreprises) emploient la majorité des salariés des services aux particuliers.
[12] Optimisation juridique consistant pour une entreprise à déclarer totalement ou partiellement tout ou une partie des éléments de son activité dans un pays européen ou le droit (en l’occurrence, le droit du travail) est le moins contraignant.
[13] Lors d’une interview le mercredi 26 août 2015 sur Europe 1.
[14] « Le droit du travail tue-t-il réellement le droit au travail ? », http://www.miroirsocial.com/actualite/12971/le-droit-du-travail-tue-t-il-reellement-le-droit-au-travail
[15] Sources : Eurostat et Ameco, base de données de la direction des affaires économiques et financières de l’Union européenne.
Cette inversion se caractériserait, si le projet de loi était voté, par le rôle central donné à l’entreprise dans la création de ses propres normes sociales indépendamment de celles édictées par la branche professionnelle dont elle relève et de celles élaborées par le législateur.
Ainsi rénové, le code du travail devrait, d’après ce projet, s’articuler autour de trois axes.
- D’abord, celui de la loi dont on peut penser que les 61 principes essentiels et « aseptisés » issus des travaux de la commission Badinter formeront vraisemblablement l’ensemble de l’ordre public social s’imposant à tous.
- Puis, celui de l’ordre public conventionnel qui se réfèrera aux accords collectifs de branches ou d’entreprises.
- Enfin, celui des dispositions supplétives, normes élaborées par le législateur qui, à défaut d’accords collectifs de branches ou d’entreprises, s’appliqueront aux entreprises.
Pour autant, avant de comprendre les raisons d’un tel acharnement contre le code du travail et d’identifier ces acteurs qui réclament ardemment le droit d’écrire leur propre permis de licencier, il convient au préalable de s’interroger sur deux points :
- renforcer la décentralisation de la négociation d’entreprise, est-ce une idée nouvelle du législateur ou la réaffirmation d’une volonté politique constante ?
- le patronat, porteur de cette démarche, est-il convaincu de l’adhésion des entreprises à une telle disposition ?
Renforcer la décentralisation de la négociation collective au niveau de l’entreprise : approche juridique nouvelle ou vieille lune politique ?
La négociation collective au niveau de l’entreprise a fait l’objet d’une promotion continue depuis la fin des années 1970. Mais, c’est la troisième loi Auroux [1] qui la relance comme instrument privilégié de régulation sociale dans les entreprises. Pour ce faire, elle propose plusieurs leviers tels que l’instauration d’obligations périodiques à négocier, l’ouverture de possibilités d’accords dérogatoires et des incitations fiscales.En encourageant ainsi les négociations au niveau de l’entreprise, le législateur veut, par cette loi, donner sens au principe constitutionnel de participation instauré par l’alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946 en rendant plus concret le droit des salariés à la négociation collective de l’ensemble de leurs conditions d’emploi et de travail et de leurs garanties sociales.
Les lois de 1998 et 2000 portant sur l’ARTT accélèrent de manière importante les négociations d’entreprise. Plusieurs autres lois en abondent les règles et les contenus. Toutefois, c’est la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 qui modifie profondément les mécanismes de la négociation collective en altérant le principe de faveur qui fonde alors la hiérarchie des normes [2].
Elle réorganise, en effet, les rapports entre les conventions et accords collectifs conclus à des niveaux différents, en accordant davantage d’autonomie à la négociation d’entreprise ou d’établissement [3].
En outre, elle offre la possibilité à l’employeur de négocier des accords collectifs avec des élus du personnel (comité d’entreprise, délégués du personnel) en cas d’absence de délégués syndicaux, d’une part et d’autre part, définit des modalités de consultation directe des salariés, sous forme de référendum permettant la ratification de certains accords collectifs. C’est ce que l’on appelle dans le jargon administratif : les processus atypiques de négociation [4].
En France, la régulation sociale est un fait politique. Le législateur ne traduit, dans les textes, que la volonté politique de ceux qui gouvernent.
Aujourd’hui, par le développement, l’élargissement et la décentralisation de la négociation collective, l’intention politique vise à favoriser clairement la montée en puissance du contrat dans l’ordre juridique qui régit les relations professionnelles.
Les propos du ministre François Rebsamen, lors de son audition à la commission « croissance, activité et égalité des chances économiques » du 11 mars 2015 au Sénat sont, à ce titre, révélateurs d’une telle ambition : « le contrat de travail n’impose pas toujours un rapport de subordination entre l’employeur et le salarié. Il est signé entre deux personnes libres qui s’engagent mutuellement ».
Ainsi, si le projet est voté, la négociation collective d’entreprise ne se contentera plus d’adapter, de modifier voire d’effacer la loi.
Elle se posera en processus législatif principal se substituant au législateur pour définir la loi sociale, rendant, de fait, les salariés (encore plus) inégaux en droit.
À cet égard, l’article 1 issu du rapport Badinter chargé de définir des principes essentiels du droit du travail est le fondement d’une telle orientation. Cet article suggère que les libertés et droits fondamentaux de la personne (salariée ?) dans la relation de travail peuvent être limités par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise.
Rappelons que la caractérisation du « bon fonctionnement » de l’entreprise relève du pouvoir de direction. Et d’influence de l’employeur.
Le patronat, porteur de cette orientation, pense-t-il réellement que les entreprises s’empareront d’une telle disposition ?
À l’origine, le patronat s’oppose à la décentralisation de la négociation voulue par la loi du 13 novembre 1982. Il y voit une entrave [5] au bon fonctionnement de l’entreprise, simple lieu neutre voué à la production.Mais les effets de la crise économique des années 1970, la levée des barrières douanières à l’intérieur de l’Europe, l’internationalisation des économies mais également (et surtout) les nouvelles idéologies managériales véhiculées par des gourous autoproclamés du management lui font prendre conscience de l’opportunité d’une telle orientation.
La négociation devient alors, pour une partie du patronat, un outil de gestion. La négociation ne doit plus se centrer sur le conflit d’intérêt, c’est-à-dire la recherche d’une maximisation des « gains » de chaque partie mais sur la conquête de nouveaux champs relevant auparavant de son pouvoir de gestion.
En impliquant ainsi les organisations syndicales dans les transformations de l’organisation, les modalités de gestions des ressources humaines voire la définition du volume d’emploi, les employeurs encouragés par le législateur transforment ipso facto la négociation collective en levier de flexibilisation.
Les entreprises tentent ainsi de produire des accords basés sur une logique d’adaptation, c’est-à-dire donnant-donnant (ex : maintien du volume d’emploi en contrepartie d’une diminution du nombre de RTT) leur permettant par la même occasion d’éviter la création de nouveaux acquis sociaux.
Pour autant, les entreprises sont-elles prêtes à s’inscrire dans une telle démarche, à savoir écrire leurs propres normes sociales ?
Qualitativement, et ce malgré la diversification des thèmes de négociation voulue par le législateur, les négociations d’entreprise restent principalement centrées sur les salaires (environ 33 % des accords en 2014), le temps de travail (environ 21 % des accords en 2014) et l’épargne salariale (environ 16 % des accords en 2014) [6].
Quantitativement, le taux d’accords d’entreprise signés au regard du nombre d’entreprises en capacité de signer des accords reste ridiculement faible, voire « epsilonesque ».
Pour l’année 2013, le ministère du Travail en recense quelque 36 500, dont 5 500 signés par des élus dans le cadre des processus atypiques de négociation.
Selon l’INSEE, le nombre d’entreprises s’élève, la même année, à quelque 3 752 544, dont 1 185 637 entreprises d’un salarié et plus.
Ainsi, seules 3 % des entreprises signent des accords collectifs [7].
Par quelle opération, les 97 % d’entreprises préférant jusqu’à présent s’en remettre à la loi s’empareraient subitement de l’occasion qui leur est donnée pour produire leur propre norme sociale ? D’autant que l’un des principaux freins qu’elles évoquent lorsqu’on les interroge est le risque juridique majeur qu’elles encourent en cas d’accord « mal ficelé ».
Qui sont donc ces dirigeants qui réclament la mise en place d’une telle disposition ?
Depuis le décret n° 2008-1354, pris en application de la loi de modernisation de l’économie, l’entreprise ne se détermine plus simplement selon des critères économiques ou juridiques. Elle se définit d’abord comme la plus petite combinaison d'unités légales (personnalité juridique morale ou physique) qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes.
Cette approche permet d’assimiler chaque groupe [8] à une entreprise.
Ainsi, les entreprises sont officiellement classées en quatre catégories de taille [9], en tenant compte non seulement des effectifs employés mais aussi du chiffre d’affaires et du total de bilan.
En 2011, on distingue ainsi (hors secteur agricole et hors administration) :
- 243 grandes entreprises (GE) [10], dont 214 hors activités financières et assurances, occupant près de 4,5 millions de salariés,
- 5 000 entreprises de taille intermédiaires (ETI) occupant près de 3,4 million de salariés,
- 138 000 petites et moyennes entrerprises (PME) [11] occupant près de 4,2 millions de salariés,
- et 3 millions de micro-entreprises occupant plus de 2,9 millions de salariés.
On comprend ainsi aisément que les GE, plus particulièrement celles qui ne relèvent pas des activités financières et d’assurances, ainsi que les ETI sous tutelle économique de leurs donneurs d’ordres, sont particulièrement intéressées par la place centrale que le législateur souhaite donner à la négociation d’entreprise.
À ce jour, leurs accords collectifs d’entreprises sont généralement plus favorables que les accords des branches dont elles dépendent. Or, la négociation collective autrefois considérée comme une contrainte est aujourd’hui (pour elles) un outil d’adaptation aux pressions concurrentielles devant leur permettre de revenir sur certains acquis sociaux.
La loi Warsmann du 22 mars 2012, puis l’ANI du 11 janvier 2013 et la loi du 14 juin 2013 n’autorisent les entreprises, en cas de difficultés économiques, de revenir que temporairement sur certains acquis sociaux (augmentation du temps de travail sans compensation salariale voire baisse des salaires) encadrant malgré tout les velléités de l’employeur. Le cas de l’entreprise Smart appartenant au groupe Daimler AG est à ce titre emblématique.
Pour autant, dans un contexte international de « shopping law » [12], elles estiment que le carcan législatif ainsi que le cadre conventionnel actuel restent des freins au développement de leur compétitivité et à la réalisation de leurs marges. Il convient donc de les refonder à leur avantage. Le code du travail reste le fléau n° 1 des patrons français, sic Pierre Gattaz [13] et des patrons dirigeant les 0,2 % des entreprises recensées.
Finalement, pour un nombre très limité d’entreprises, la production de leurs propres normes sociales devient un avantage stratégique et économique non négligeable qu’il convient de développer, quitte à l’imposer à l’ensemble des entreprises et des salariés.
Il est clair que la possibilité donnée aux accords d’entreprise de s’affranchir de l’édifice juridique actuel n’a d’autre ambition que celle de la diminution du coût du travail.
Dans un précédent article [14], j’avais souligné que la règlementation sociale n’était pas un frein au développement économique et social d’un pays comme d’une entreprise mais la cause en était bien l’évasion et l’optimisation fiscale et sociale. Elle représente quelque 6,7 % du PIB [15].
J’avais également mis en exergue la primauté de la distribution de dividendes au détriment de l’investissement productif et de la création d’emplois.
Ce projet de loi ne profitera, donc, ni à l’entreprise dans le cadre de la reconstitution de son appareil productif, ni aux salariés dans le cadre du maintien de leurs avantages acquis, ni à l’emploi dans le cadre de la lutte contre le chômage.
Il profitera à l'évidence aux actionnaires de ces entreprises.
[1] La loi n°82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail.
[2] Un contrat de travail ne pouvait recéler des clauses moins favorables que celles prévues par l’accord d’entreprises, qui elles-mêmes ne pouvaient être inférieure à celle de l’accord de branche, accord de branche qui ne pouvait être moins favorable aux salariés que la loi
[3] Ainsi, une convention ou un accord collectif d’entreprise peut déroger, y compris dans un sens moins favorable pour les salariés, aux dispositions d’une convention ou d’un accord conclu à un niveau supérieur (branche, professionnel, interprofessionnel), tant que l’accord de niveau supérieur ne l’a pas expressément exclu (CT art. L. 2253-3, al. 2). La dérogation reste proscrite dans certaines matières : salaires minima, classifications, protection sociale complémentaire et fonds de la formation professionnelle (C. trav., art. L. 2253-3, al. 1er).
[4] Cf articles L2232-21 à 23 du code du travail (réservés aux entreprises, de moins de 200 salariés, dépourvues de délégués syndicaux).
[5] Cf interview d’Yvon Chottard, vice-président du CNPF, dans Le Monde du 9 février 1982.
[6] Bilan de la négociation collective en 2014, DGT.
[7] 36 500 accords (dont 5 500 signés dans le cadre des processus atypiques) par rapport aux 1 185 637 entreprises (dont 1 177 867 entreprises de moins de 200 salariés).
[8] Selon l’INSEE, un groupe de sociétés est une entité économique formée par un ensemble de sociétés qui sont soit des sociétés contrôlées par une même société, soit cette société contrôlante. Contrôler une société, c'est avoir le pouvoir de nommer la majorité des dirigeants. Le contrôle d'une société A par une société B peut être direct (la société B est directement détentrice de la majorité des droits de vote au conseil d'administration de A) ou indirect (B a le contrôle de sociétés intermédiaires C, voire D, E, etc. à qui elle peut demander de voter d'une même façon au conseil d'administration de A, obtenant ainsi la majorité des droits).
[9] INSEE Focus n° 4, avril 2014.
[10] Une grande entreprise est une entreprise qui a au moins 5 000 salariés. Une ETI a entre 250 et 4 999 salariés. Les PME occupent moins de 250 personnes. Une micro-entreprise emploie moins de 10 personnes.
[11] Selon l’INSEE, les PME (y compris les micro-entreprises) emploient la majorité des salariés des services aux particuliers.
[12] Optimisation juridique consistant pour une entreprise à déclarer totalement ou partiellement tout ou une partie des éléments de son activité dans un pays européen ou le droit (en l’occurrence, le droit du travail) est le moins contraignant.
[13] Lors d’une interview le mercredi 26 août 2015 sur Europe 1.
[14] « Le droit du travail tue-t-il réellement le droit au travail ? », http://www.miroirsocial.com/actualite/12971/le-droit-du-travail-tue-t-il-reellement-le-droit-au-travail
[15] Sources : Eurostat et Ameco, base de données de la direction des affaires économiques et financières de l’Union européenne.
Pas encore de commentaires