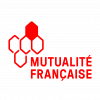Organisations
Le mutualisme dans la sphère sociale, une réponse aux défis du monde actuel !
François-Emmanuel Blanc, Directeur Général de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole, a bien voulu apporter ses réponses aux questions du CRAPS (Le Cercle de Recherche et d'Analyse sur la Protection Sociale).
D’OÙ VIENT LE MUTUALISME ?
Le mutualisme est le plus ancien mouvement social en France et prend ses racines dans les confréries et le compagnonnage qui ont émergé à une époque où l’État social n’existait pas encore. C’est un mouvement spontané d’individus qui décident de s’associer pour faire face collectivement aux risques de la vie, dont ils ne peuvent seuls assumer les conséquences, à une époque où les risques sociaux (la maladie, le handicap, la vieillesse…) étaient laissés pour compte.
C’est avant tout un mouvement d’action : faire ensemble ce que l’on ne peut pas faire seul. Une véritable force d’action sociale, démocrate, humaniste qui a fait ses preuves dans l’histoire au regard de sa longévité.
JUSTE CE MOUVEMENT MUTUALISTE N’EST-IL PAS, PAR NATURE, SURANNÉ ?
Bien au contraire. Si le mutualisme a autant participé à la construction de notre histoire sociale, c’est justement parce qu’il a su apporter des réponses adaptées qui montraient la voie.
Le mutualisme est un véritable laboratoire d’innovations sociales. C’est donc par essence un mouvement avant-gardiste : il imagine, conçoit, propose et porte des actions qui tendent à un mieux-être social.
Prenons l’exemple des mutualités maternelles développées à la fin du XIXe : les ouvrières ont versé une petite cotisation, complétée par une participation patronale ; en échange, elles ont eu droit à un arrêt de travail après leur accouchement. Ce dispositif est l’ancêtre du congé maternité !
OÙ EN EST LE MUTUALISME AUJOURD’HUI ?
La protection sociale est par nature un domaine mouvant, en permanente évolution. Le mutualisme, grâce à sa capacité d’adaptation, me paraît justement la meilleure réponse face aux défis et risques nouveaux.
Je rejoins Éric Chenut, Président de La Mutualité Française, lorsqu’il évoque un éloignement, réforme après réforme, d’une forme de citoyenneté sociale et qu’il convient de préserver des espaces d’engagement des parties prenantes (assurances maladie, mutuelles, organisations de santé, associations de patients, professionnels de santé, collectivités locales…) et de « réinterroger le système ».
En effet, l’État doit jouer son rôle, mais sans décider de tout : il fixe les grands principes et garantit leur application, mais il m’apparaît indispensable de maintenir la capacité et la complémentarité d’action des acteurs de terrain et des opérateurs. Le modèle mutualiste est un modèle où chaque voix compte, où chaque personne, quelle qu’elle soit, égale une voix.
Notre époque, traversée par de profondes mutations (environnementales, numériques, sanitaires, développement de nouvelles inégalités, mondialisation, guerres…), n’a jamais eu autant besoin de cette « nécessité démocratique », de ces solidarités pour refabriquer du commun et retisser des liens.
ET LE MUTUALISME DANS LE MONDE AGRICOLE ?
Là où la société connaît des mutations, je parlerais pour l’agriculture de révolution avec ce double enjeu vital de nourrir une population croissante tout en abaissant ses impacts sur l’environnement voire en participant à sa préservation.
Je crois sincèrement que le modèle mutualiste est une opportunité formidable pour agir au plus près des besoins de professionnels agricoles confrontés à ces défis inédits.
« Aller vers » constitue la force de ce modèle qui porte en lui cette capacité d’identifier les situations et les personnes en difficulté et de proposer un accompagnement en réponse à leurs besoins, voire d’alerter quand il y a urgence.
À la MSA, très concrètement, cet « aller vers » va du risque lourd comme détection des personnes en détresse (grâce notamment à la structuration et la formation de réseaux Sentinelles) jusqu’à la résolution d’une difficulté administrative en passant par un accompagnement lors d’un passage difficile, qu’il soit professionnel ou familial.
QU’EST-CE QUI DIFFÉRENCIE LA MSA DU RÉGIME GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ SOCIALE ?
Justement, son modèle mutualiste ! La MSA est le seul régime de Sécurité sociale à disposer d’élus qui sont de véritables relais, voire des vigies, au plus près des réalités locales: près de 14 000 délégués cantonaux et plus de 200 associations constituent plus qu’une spécificité, une véritable nécessité. Il faut faire vivre cette force de l’engagement du premier kilomètre, où naissent les énergies; faire vivre également celle du dernier, parce qu’il y a des territoires où, s’il n’y avait pas de bénévoles, il n’y aurait (presque) plus rien.
Ce réseau unique de bénévoles, qui s’appuie sur des salariés MSA engagés, permet aux pouvoirs publics de renforcer leur présence en milieu rural, d’améliorer les conditions de vie dans les territoires, en apportant des services au profit de l’ensemble du monde rural auprès des familles, des personnes âgées, en situation de handicap, éloignées de l’emploi ou d’un parcours de soins.
Interlocuteur unique de ses ressortissants, la MSA est également le seul régime organisé en guichet unique permettant une approche globale de la personne sur tous les risques (santé, famille, retraite, accident du travail et maladie professionnelle) et un accompagnement personnalisé à 360°.
ET DEMAIN ?
Soyons lucides: les jeunes ne connaissent pas ou pas bien le mutualisme alors qu’intrinsèquement il propose le principe de fonctionnement démocratique à l’instar de ce qu’ils vont chercher chez les acteurs de l’ESS (associations, syndicats, coopératives). Il s’agit donc en premier lieu de faire (re)connaître ce modèle.
Il s’agit également de le faire évoluer : nous devons proposer des modes alternatifs d’engagement plus fluides, mais aussi plus concrets, davantage ancrés dans l’action. Thierry Beaudet, président du CESE, parle à ce sujet de « circuits courts de l’engagement »: accepter l’idée, et surtout permettre, qu’un jeune puisse s’engager ponctuellement sur une action qui a du sens pour lui.
J’ai écrit en début de tribune que le mutualisme était là pour innover au risque d’être en danger ; élargir et assouplir les modes d’engagement dans notre modèle sont des enjeux que nous devons relever aujourd’hui pour assurer le renouvellement des générations et ainsi la pérennité du modèle.
- Protection sociale parrainé par MNH
- Relations sociales