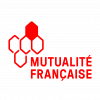Organisations
Exonérations de cotisations: retour sur les dispositifs existants et futurs
Les caisses nationales de sécurité sociale ont été saisies d’un projet de décret d’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, portant sur la refonte des dispositifs d’allègement de cotisations sociales. Nos délégations, dans chaque caisse, ont voté contre ce projet, qui n’aura que peu d’effet sur les recettes de la sécurité sociale.
Alors que les débats politiques battent leur plein autour du budget pour 2026, et que plusieurs rapports pointent du doigt les effets néfastes des mesures d’exonérations, qui ne cessent de s’empiler, il nous a paru intéressant de revenir sur ces dispositifs, dont le montant atteint plus de 80 milliards d’euros en 2024...pour mieux appréhender les effets qui en découlent...
I. L’historique des mesures d’exonération
La création des premières mesures d’exonération ne date pas d’hier, elles sont issues d’un long processus législatif débutant au tout début des années 80 :
- 1979 – 1985 : création des premières exonérations ciblées : apprentis, aide à la création et à la reprise d’une entreprise, contrats aidés, recherche, aménagement du territoire, sport professionnel…
- 1993 : Création des premières mesures d’allègement général par le gouvernement Balladur. Cette réforme crée une réduction des cotisations d’allocations familiales dues par l’ensemble des employeurs (pour les salaires compris entre 1 et 1,2 Smic). L’objectif du gouvernement Balladur était de : « baisser le coût du travail en général », et non d’agir « uniquement sur le travail non qualifié ».
- 1995 : Réduction dégressive sur les bas salaires (dite « ristourne Juppé » - loi du 4 août 1995). La fusion du dispositif Balladur et Juppé a abouti à une réduction dégressive entre 1 et 1,3 Smic (avec un taux maximum de 18,20 %).
- 2000 : Les lois Aubry, avec des allègements dits à « caractère défensif ». Il ne s’agit pas de baisser le coût du travail, mais d’éviter qu’il n’augmente à la suite des hausses des salaires horaires associées à la compensation de la baisse de la durée du travail. La première aide, dite « Aubry I », était une aide fixe incitative (entre 5 000 francs et 9 000 francs par salarié). La deuxième aide, dite « Aubry II », cumulait une aide fixe de 4 000 francs et une aide dégressive entre 1 et 1,7 Smic.
- 2003 : Réforme dite « réduction Fillon ». L’objectif était de « simplifier » les dispositifs existants (fusion de la ristourne Juppé et de la loi Aubry II). Désormais un barème d’allègement unique s’applique, que les entreprises soient ou non à 35 heures. La réduction est de 26 points de cotisations pour les salaires au niveau du Smic, et elle décroit au-delà de ce niveau pour s’annuler à 1,7 Smic. La loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 a ramené ce seuil à 1,6 Smic. La loi de finances pour 2007 a majoré le taux de réduction pour le passer à 28,1 points dans les entreprises de moins de 20 salariés.
- 2012 : La LFSS pour 2012 intègre les heures supplémentaires dans la formule de calcul de l’allègement
- 2014 : Loi du 8 août 2014, mettant en œuvre le « pacte de responsabilité et de solidarité », elle a poussé à son paroxysme la logique de l’allègement général, en le renforçant de façon à créer un dispositif « zéro cotisation URSSAF » : à compter de 2015, cet allègement prend la forme d’une exonération complète, au niveau du Smic, de l’ensemble des cotisations patronales de Sécurité sociale recouvrées par les URSSAF à l’exception des cotisations de retraites complémentaires, d’assurance chômage et d’AT-MP, ce qui conduit à exonérer 1,4 milliard d’euros de cotisations supplémentaires.
- Par ailleurs le gouvernement lance le CICE un avantage fiscal à destination des entreprises soumises à un régime réel d’imposition et qui emploient des salariés en France. Son coût est de 20 Md€/an.
- 2016 : Le renforcement des allègements généraux s’est accompagné de la réduction des cotisations d’allocations familiales dues pour l’emploi des travailleurs salariés, au moyen d’une baisse de 1,8 point (soit un taux de 3,45 % contre 5,25 % auparavant) pour les salaires dont le montant annuel est inférieur à un seuil de 3,5 fois le Smic (après l’extension de cette exonération à compter du 1er avril 2016). On appelle cette réforme le « bandeau famille », le seuil d’exonération est donc cette fois-ci allongé et ne concerne plus uniquement les bas salaires.
- 2018 : renforce à nouveau les allégements généraux, d’une part en transformant le CICE en allégement pérenne de 6 points de la cotisation patronale d’assurance maladie pour les salaires inférieurs à 2,5 Smic (« bandeau maladie »). D’autre part en intégrant dans la réduction générale dégressive les cotisations dues au titre des retraites complémentaires ainsi que, à compter du 1er octobre 2019, les cotisations d’assurance chômage, renforçant ainsi de plus de 10 points le montant des cotisations exonérées au niveau du Smic.
Au terme de ces extensions, la réduction générale dégressive, à laquelle s’ajoutent les deux exonérations proportionnelles des cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales, permet d’exonérer au niveau du Smic une grande majorité des cotisations obligatoires prélevées sur l’ensemble des salaires.
II. Les dispositifs d’exonérations :
Les mécanismes d’exonérations se composent de deux grands ensembles :
1) Les allègements généraux : ils se caractérisent par un abaissement du montant des cotisations patronales de Sécurité sociale versées par l'employeur. Ces allègements comportent trois principales composantes :
- la réduction dégressive portant sur les salaires compris entre 0 et 1,6 Smic, dite « allègement Fillon » ;
- la réduction de 6 points de cotisations maladie portant sur les salaires compris entre 0 et 2,25 Smic dite « bandeau maladie » ;
- la réduction d’1,8 point de cotisations familiales portant sur les salaires compris entre 0 et 3, Smic dite « bandeau famille »
*Source : URSSAF Caisse nationale:
De 2014 à 2024, le total des allègements généraux de cotisations patronales du secteur privé a presque quadruplé, passant de 20,9 Md€ à 77,3 Md€.
2) Les exonérations ciblées et spécifiques : Qui s’appliquent soit à des publics particuliers (aides à domicile, indépendants, etc.), à des zones géographiques précises (zones de revitalisation rurale, zones franches urbaines, etc.).
→ La mesure la plus connue : les heures supplémentaires. Pour calculer le montant de l'exonération, sont prises en compte les cotisations légales d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire dans la limite de 11,31 %.
*Sources : LFSS, Cour des Comptes, DSS
III. Les dispositifs d’exemptions :
En plus, des dispositifs d’exonérations, l’on retrouve des mécanismes d’exemptions d’assiette. Ces exemptions se distinguent des exonérations : elles consistent à exclure certains revenus de l’assiette soumise aux prélèvements. En conséquence, les sommes versées dans ce cadre ne sont pas assujetties à cotisations, voire à contributions sociales. Ce sont des pertes sèches pour le budget de la Sécurité sociale.
Ces exemptions peuvent être regroupées en quatre catégories :
- Les dispositifs de participation financière (intéressement, participation, plan d’épargne d’entreprise) ou d’actionnariat salarié (stock-options, actions gratuites);
- Les accessoires de salaire qui prennent en général la forme de chèques ou de titres de paiement- destinés au financement de besoins fléchés : restauration, vacances, services à domicile;(1)
- Le financement de la protection sociale complémentaire collective et obligatoire (prévoyance complémentaire(2) et retraite supplémentaire(3) ;
- Les indemnités versées dans certains cas de rupture du contrat de travail (plan de sauvegarde de l’emploi, licenciement, rupture conventionnelle) ;(4) Le coût des exemptions d’assiette est estimé à 14,6 Md€ en 2024 il est en hausse de 13,53% par rapport à 2022. Ce coût passerait à 15,1 Md€ en 2025.
IV. Conséquences de ces dispositifs
Les mesures d’exonérations et d’allègements généraux se sont développées de manière continue, notamment au cours de la dernière décennie. Elles reposent sur le postulat que le fort taux de chômage des moins qualifiés résulte d’un Smic et d’un « coût du travail » trop élevés.
Si, à l’origine, ces mesures ciblaient des salaires proches du Smic, elles ont progressivement été étendues à des rémunérations plus élevées, atteignant aujourd’hui 3,3 Smic.
Résultat : 9 salariés sur 10 bénéficient d’un dispositif d’allègement.
Conséquences ? un taux effectif de cotisation au Smic qui passe de 45% au début des années 80 à 7,2% aujourd’hui.
Nous déplorons ce phénomène. L’inefficacité de ces politiques dites de l’emploi se démontre facilement au moyen d’une étude simple et sérieuse. La transformation du CICE en allègement supplémentaire en 2019 a entraîné le versement de plus de 40 milliards d’euros aux entreprises, ce qui équivaut à la rémunération de 2 millions de salariés… Pour rappel, selon les analyses visant à légitimer ces mesures, à peine 200 000 à 250 000 emplois à moyen/long terme ont été préservés pour un coût de mesures se comptant en dizaines de milliards d’euros.
Ces allégements/exonérations de cotisations sociales, ciblés ou non, bénéficient donc à des entreprises qui soit ne créent pas d’emplois (voire en détruisent), soit qui en auraient créé même en l’absence de toute mesure d’allègement de cotisations. On constate donc un véritable « effet d’aubaine ».
Si des mesures d’aides ciblées aux entreprises peuvent être nécessaires, pour des secteurs particuliers ou des espaces géographiques, l’État dispose de moyens propres sans qu’il ait besoin de perturber le financement de la Sécurité sociale.
Ainsi, ces mesures d’exonération boostent la trésorerie des entreprises, sans qu’il y ait un effet probant sur l’emploi.
Qui plus est, notre confédération dénonce la multiplication de ces mesures qui viennent fragiliser le financement de la Sécurité Sociale, du fait d’une compensation partielle… En effet, le volume des non-compensations des mesures ciblées (2,9 milliards en 2024) a repris sa hausse, notamment avec les exonérations de charges octroyées durant la crise du Covid 19, auxquelles s’ajoutent les pertes sèches des exemptions d’assiette.
➢ Au-delà et surtout, ces exonérations ont pour conséquence :
➢ De développer la fiscalisation de la Sécurité sociale (la cotisation ne représente que 48% de financement de notre modèle social, plus de 50 % est financé par la CSG/CRDS, et la TVA essentiellement (5), donc son étatisation. Les gouvernements successifs opèrent un basculement de notre système d’assurance sociale vers de la charité publique. Cela a pour effet d’une part de faire payer la Sécurité sociale par les ménages, en faisant disparaître le financement des entreprises, et rend interdépendants les budgets de l’Etat et de la Sécurité sociale. Ainsi en cas de nouvelle crise, quel choix l’Etat opèrera-t-il sur les affectations de recettes si son propre solde budgétaire, déjà très dégradé plonge davantage ? Cette évolution remet en cause les droits ouverts par les cotisations (et donc le droit à prestation), ainsi que le droit de regard et de gestion confié aux représentants des travailleurs.
➢ Une dépendance accrue à la dette : Les pertes de recettes induites par les mesures d’exonérations sont la principale cause du déficit de la Sécurité sociale (qui s’élève à 15,3 Md€ pour 2024. L’emballement du déficit est devenu désormais supérieur à la capacité annuelle de financement de la CADES. Ainsi, le financement des déficits nouveaux de la Sécurité sociale n’est plus assuré depuis 2024 par la Cades, dont les ressources doivent servir à rembourser la dette sociale qui lui a été affectée jusqu’à la cessation de son activité, prévue en 2033. Le creusement de la dette sociale est donc supporté désormais par l’URSSAF Caisse nationale,- qui gère la trésorerie des branches. En l’absence de réformes, cette dette augmentera rapidement et pourrait atteindre selon la Cour des comptes (6 ) près de 115 Md€ en 2028. Comme le rappellent très justement les hauts magistrats : le niveau de dette croissant qui pèse ainsi sur l’URSSAF Caisse nationale contrevient à la mission de cette agence qui, comme la Sécurité sociale dans son ensemble, « n’a pas vocation à s’endetter ». Ce constat n’est pourtant pas nouveau, notre organisation syndicale a de maintes fois rappelé que le creusement de la dette sociale, désormais supporté par l’URSSAF Caisse nationale est lié au transfert de la dette COVID à la CADES (7) ainsi qu’aux multiplications des mesures d’exonérations.
➢ Ces mesures sont aussi de véritables trappes à bas salaire. En effet comme le note le Conseil d’Analyse Economique (CAE) dans un rapport 2019 (8), les exonérations sur les bas salaires ont incité les entreprises à créer ou préserver des emplois peu qualifiés au détriment des emplois qualifiés, ce qui en conclusion tire l’économie française vers le bas. Étant donné les baisses dégressives de cotisations sociales, l’employeur n’est pas incité à augmenter les salaires et les salariés sont moins encouragés à améliorer leur productivité ou à se former pour obtenir un poste plus qualifié » (9). Le constat est sans appel : aujourd’hui, 15% des salariés sont au Smic alors que cette proportion était de 4% au début des années 70.
➢ D’augmenter les dépenses de la Sécurité sociale : C’est l’effet pervers des exonérations : pour compenser la trappe à bas salaire c’est la Sécurité sociale qui prend en charge le complément de revenu via la prime d’activité qui coûte environ 10 md€/an à la Sécurité sociale. C’est donc une double peine pour les finances de la sécu ! Autrement dit, l’essentiel des gains de pouvoir d’achat d’un salarié au Smic n’est plus lié à la reconnaissance de son travail ni à ses qualifications mais au devoir de solidarité. Une solidarité toute relative qui exonère les employeurs du paiement du salaire. Une solidarité qui reconnaît par ailleurs que le salaire minimum n’est pas suffisant pour vivre au quotidien.
V. Un constat partagé :
Plusieurs rapports récents soulignent le dérapage du montant des exonérations de cotisations :
➢ Le rapport dit « Guedj-Ferracci » (10), en conclusion des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur le contrôle de l’efficacité des exonérations de cotisations sociales. Le principal constat est l’existence : « d’un effet d’emballement » du montant des exonérations générales de cotisations sociales. De plus, le rapport met en évidence que plus une exonération s’applique à des rémunérations élevées, moins son efficacité est avérée. Parmi ses recommandations figure notamment la suppression du « bandeau famille ».
➢ Le rapport Bozio-Wasmer (11) relatif à l’articulation entre les salaires, le coût du travail et la prime d’activité et à son effet sur l’emploi, le niveau des salaires et l’activité économique, conclut à la nécessité d’une : « inflexion », concernant les exonérations. Le rapport met en évidence qu’il existe des: « effets de trappes à bas salaires ». À court terme, les auteurs recommandent de réduire de 4,05 points les exonérations de cotisations au niveau du Smic et de supprimer les « bandeaux », maladie et famille. Cela permettrait d’abaisser fortement la pente des allègements pour un point de sortie autour de 2,5 Smic. À plus long terme, le rapport insiste sur la nécessité de rendre ces dispositifs plus lisibles et propose de ne conserver que deux barèmes d’exonération : l’un relevant du régime général, l’autre pour les publics « particulièrement sensibles au coût du travail ».
➢ La Cour des comptes dans son rapport sur l’application des lois de financement de la Sécurité sociale (12), note que les mesures d’allègement font que le coût du travail au Smic rapporté à celui au salaire médian, est en France parmi les plus faibles de l’OCDE : 44 % contre 51,2 % en moyenne. Cela infirme l’idée selon laquelle notre pays serait le « champion du monde » du coût du travail. Selon la Cour : « Dans le contexte de dégradation de l’équilibre financier de la Sécurité sociale, une meilleure maîtrise de la dynamique des allègements généraux de cotisations sociales est nécessaire tout en tenant compte des enjeux économiques associés, tels le besoin de prévisibilité des entreprises et les contraintes ponctuelles liées à la conjoncture économique (renchérissement du coût de l’énergie ou surcapacités industrielles et politique commerciale offensive de la part des partenaires commerciaux). » Les hauts magistrats préconisent :
- Un élargissement de l’assiette de la rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction générale dégressive. De ce fait, le plafond d’éligibilité est atteint moins rapidement, ce qui tend à amplifier la perte de cotisations. La cour préconise d’y intégrer la participation financière et l’actionnariat salarié.
- Un plafond d’éligibilité (3,25 Smic), jugé par les travaux d’évaluation marginaux sur l’emploi et complexes à caractériser en termes de compétitivité. Celui-ci pourrait être ramené à 2,5 Smic, compensé en tout ou partie par une modulation des impôts de production.
➢ Un rapport de la commission d’enquête Sénatoriale (13) sur : « la transparence et évaluation des aides publiques aux entreprises » : souligne que le montant total des aides publiques aux entreprises s’élève à au moins 211 milliards d’euros en 2023 (comprenant les mesures d’exonération). Le rapport insiste sur le fait « qu’il est impossible de déterminer avec précision le montant des aides publiques ». La commission d’enquête, préconise notamment :
- De rationaliser les aides publiques par trois (recommandation n°12) tout en poursuivant la réflexion sur l’efficacité des allègements de cotisations sociales dans le secteur privé (recommandation n°17).
- De conditionner l’octroi des aides publiques dans leur intégralité, notamment en cas d’infractions graves ou de délocalisation (recommandation n°19 & 20).
VI. La réforme des exonérations
L’article 18 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 réforme en profondeur les dispositifs d’allègement de cotisations sociales. Cette refonte s’opère en deux étapes :
➢ A compter du 1er janvier 2025 :
- Le point de sortie du bandeau maladie est ramené à 2,25 Smic (contre 2,5 Smic avant la LFSS)
- Le point de sortie du bandeau famille est porté à 3,3 Smic (contre 3,2 Smic avant la LFSS).
➢ A compter du 1er janvier 2026 : la mise en œuvre d’un dispositif unique de réduction générale Le décret n°2025-887 du 4 septembre 2025 précise la seconde étape de la réforme. Il instaure une « réduction dégressive unique », avec un point de sortie fixé à 3 Smic (contre 1,6 Smic auparavant), en supprimant les bandeaux famille et maladie. Ainsi, l’exonération sera maximale au niveau du Smic, puis dégressive jusqu’au point de sortie fixé à 3 Smic. Par ailleurs, un socle minimal d’exonération est fixé à 2 % pour l’ensemble des rémunérations entrant dans le champ d’application de la "réduction dégressive" unique.
➢ Le rendement attendu ici est de 1,6 md€/an.
Source : URSSAF Caisse nationale
Conformément à la LFSS pour 2025, un comité de suivi indépendant est chargé d’évaluer les allègements généraux de cotisations sociales patronales et de suivre la mise en œuvre de la réforme.
Selon le décret, ce comité est rattaché au Haut-commissariat à la stratégie et au plan. Pour rappel, l’article 18 V de la LFSS précise que ce comité :
- est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre ;
- comprend deux députés et deux sénateurs,
- ainsi qu’un nombre égal de représentants des administrations compétentes et des organisations professionnelles d’employeurs et syndicales.
Il devra publier un rapport sur l’état des évaluations réalisées avant le dépôt des PLFSS pour la période 2026-2030.
La délégation FO a voté contre ce projet de décret :
- En effet, les recettes attendues (1,6 Md€/an) restent dérisoires au regard du coût total des allègements généraux (77,3 Md€ pour la seule année 2024). Il s’agit d’une réforme essentiellement paramétrique, qui se limite à des effets de substitution sans impact réel sur les comportements des entreprises. Le seuil de sortie fixé à 3 Smic demeure particulièrement élevé.
- La création d’un plancher d’exonération de 2 %, applicable jusqu’à 3 Smic, instaure un mécanisme inédit : les employeurs bénéficieront systématiquement d’un allègement résiduel, même pour des rémunérations relativement élevées. FO rappelle que les exonérations de cotisations sociales ne sont pas un droit acquis mais une dérogation au financement solidaire de la Sécurité sociale.
- Cette mesure aura un effet négligeable sur les recettes de la Sécurité sociale et ne permettra pas de réduire les trappes à bas salaires.
VII. Les revendications de FO
Pour FO, il convient de mettre un terme aux mesures d’allègements généraux, dénoncées étude après étude comme ayant un effet nul, ou au mieux très limité sur l’emploi au regard des moyens consacrés.
FO revendique :
- La conditionnalité de toutes les aides aux entreprises ;
- La réduction immédiate du seuil de sortie des allègements généraux à 140 % du Smic, soit entre 12 et 15 Md€ de recettes supplémentaires par an ;
- La fin de l’indexation de ce seuil sur le Smic, qui ne fait que repousser artificiellement la fin des exonérations. Alors que le gouvernement souhaite imposer une année blanche aux assurés sociaux, il serait pour le moins légitime d’appliquer la même rigueur aux entreprises ;
- Une meilleure lisibilité des mesures d’exonérations ;
À plus long terme, FO revendique la suppression des exonérations massives, dont l’efficacité sur l’emploi est nulle ou marginale au regard de leur coût.
Dans le contexte social et budgétaire actuel, ce texte ne va pas assez loin. Les efforts exigés des entreprises restent minimes, alors que, dans le même temps, un budget d’austérité demande toujours plus aux assurés sociaux et aux travailleurs.
Force Ouvrière martèle, à l’occasion des 80 ans de la Sécurité sociale, qu’il est impératif de revenir aux fondamentaux de son mode de financement. Il s’agit de rétablir une équité contributive entre les entreprises et les personnes protégées, condition nécessaire pour résorber les déficits et garantir le maintien d’un haut niveau de protection sociale.
Ce qui a fonctionné il y a 80 ans au sortir de la Seconde Guerre mondiale dans une France économiquement ruinée, peut encore très bien fonctionner aujourd’hui, à condition de disposer de volonté politique et de mettre de côté les dogmes sur le « coût du travail », inefficace depuis plus de 40 ans.
(1) Notre organisation syndicale ne revendique pas la suppression de cette exemption d’assiette, le risque étant ici une diminution, voire une disparition pure et simple de ce type d’accessoires de salaire, qui constituent un gain de pouvoir d’achat pour les salariés.
(2) Exclusion pour une fraction n’excédant pas un montant égal à 6% du PASS (soit 2 826€ en 2025) et de 1,5% de la rémunération soumise à cotisation de Sécurité sociale. A ce montant est ajouté 1,5 % du montant de l'indemnisation versée pendant la période de suspension du contrat de travail ou 1,5% de la rémunération reconstituée. Le total de l’exemption ne peut pas excéder 12% du PASS (soit 5652 € en 2025) . La CSG-CRDS s’applique, ainsi qu’un forfait social de 8% si l’entreprise compte plus de 11 salariés.
(3) Exclusion pour une fraction n’excédant pas un montant égal à : 5% du PASS (soit 2 355 € en 2025) ou 5% de la rémunération soumise à cotisations de Sécurité sociale, retenue dans la limite de 5 fois le plafond de la Sécurité sociale, (soit 235 500 € en 2025). Le total de l’exemption ne peut pas excéder 12% du PASS (soit 5652 € en 2025). La CSG-CRDS s’applique, ainsi qu’un forfait social de 8% si l’entreprise compte plus de 11 salariés.
(4) L’exemption s’applique dans la limite de 2 PASS (soit 94 200€), la partie de l’indemnité qui excède ce montant est soumise à cotisations sociales. Pour la CSG/CRDS d’autres plafonds s’appliquent voir : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F987
(5 )La loi Veil impose en principe une compensation à l’euro près des mesures d’exonération. Néanmoins, la LFSS peut déroger à ce principe général (exemple du bandeau maladie & famille). Qui plus est, lorsqu’il y’a compensation celle- ci s’opère via l’affectation de recettes fiscales (essentiellement la TVA). C’est notamment le cas pour les allègements généraux.
(6) Cour des comptes, « Rapport sur l’application des lois de financement de la Sécurité sociale », Mai 2025 :https://www.ccomptes.fr/fr/publications/securite-sociale-2025
(7) FO continue de revendiquer que la dette COVID soit gérée séparément, spécifiquement, et adossée aux comptes de l’État, et qu’il n’appartient pas à l’ACOSS de se substituer aux manquements de l’Etat.
(8)Conseil d’analyse économique, « Baisses de charges : stop ou encore ? », janvier 2019 : https://cae-
eco.fr/static/pdf/cae-note049v4.pdf
(9) Si une entreprise augmente de 1 % le salaire brut d’un employé proche des seuils d’exonérations, le « coût » réel pour l’employeur augmentent bien de plus de 1 % (augmentation du salaire + baisse du montant d’exonération).
(10) « Rapport d’information parlementaire en conclusion des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur le contrôle de l’efficacité des exonérations de cotisations sociales », M.Ferracci & J.Guedj, 28 septembre 2023 : https://www.assemblee- nationale.fr/dyn/16/rapports/mecss/l16b1685_rapport-information
(11) « Les politiques d’exonérations de cotisations sociales : une inflexion nécessaire », Bozio-Wasmer, Octobre 2024 : https://www.strategie-plan.gouv.fr/files/files/Publications/Rapport/rapport_vffff_241003.pdf
(12) Cour des comptes, « Rapport sur l’application des lois de financement de la Sécurité sociale », Mai 2025 : https://www.ccomptes.fr/fr/publications/securite-sociale-2025
(13) Rapport enquête sénatoriale : « la transparence et évaluation des aides publiques aux entreprises : une attente démocratique, un gage d’efficacité économique », Juillet 2025 : https://www.senat.fr/notice-rapport/2024/r24-808- 1-notice.html
- Protection sociale parrainé par MNH