Organisations
La Sécurité sociale a 80 ans...... Que faire pour 80 de plus ?
Jean-Marie FESSLER, Docteur en éthique médicale (1997, Paris Descartes), Docteur en méthodes d’analyse des systèmes de santé (2006, Lyon I), Ancien directeur d’hôpital et des établissements de soins de la MGEN, conseiller de son président, Consulting Professor, Stanford University, Santé globale, Enseignant à l’Essec et aux Arts & Métiers, en particulier, Auteur ou co-auteur de livres et articles, a bien voulu livrer ses réflexions pour Galilee.sp
La Sécurité sociale a 80 ans. Que faire pour 80 de plus ?
S’agissant d’une telle question qui interroge nos perceptions de l’histoire et du présent de la sécurité sociale et devrait mobiliser nos facultés prospectives et le meilleur de notre intelligence collective, plusieurs étapes semblent nécessaires à parcourir.
En effet, on peut avoir été bénéficiaire toute sa vie d’une telle construction sociale et y avoir contribué plus de cinquante ans sans en appréhender véritablement l’architecture, les flux permanents de données, les lois et les règles qui l’organisent.
Explorer la sécurité sociale fait rencontrer une stratigraphie dont la mise en lumière mobiliserait sans doute de très larges compétences et expériences historiques, institutionnelles, économiques, sociologiques…
Quelques chiffres, d’abord.
Des références majeures ont été consultées. Pour autant, dans le présent format de cette note, il n’a pas été retenu de multiplier les références et citations des rapports qui émanent de l’Assemblée nationale et du Sénat, de la Cour des comptes, des Inspections des Finances et des Affaires sociales, du Haut Conseil du financement de la protection sociale, de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, de travaux internationaux comparatifs, d’ouvrages de fond et de réponses de l’IA conversationnelle ChatGPT.
On se reportera volontiers au portail du service public de la sécurité sociale, www.securite-sociale.fr, et au document annuel Les chiffres clés de la sécurité sociale.
A l’échelle d’une journée type :
- 1,5 milliard d’euros de prestations sont quotidiennement effectués ;
- 3,3 millions de boîtes de médicaments remboursés sont fournis chaque jour.
La sécurité sociale traite 1,3 milliard de feuilles de soins par an.
Les dépenses de sécurité sociale sont le premier poste de dépense des ménages. Elles sont aussi la première source de revenus pour une large part de la population, retraités, malades, familles, et nombre de professionnels, ceux de la santé en particulier.
De notre naissance à la fin de nos vies, nous est-il même possible d’imaginer ce qu’auraient été et seraient nos vies sans sécurité sociale ? Faut-il ici rappeler qu’un être humain sur deux dans le monde ne dispose d’aucune protection sociale ?
S’il n’existe pas de registre unique des cotisants depuis 1945, il est certain que la quasi-totalité des Français entrés sur le marché du travail au cours des 80 dernières années ont cotisé, à un moment ou à un autre. Aujourd’hui, environ 30 millions de personnes cotisent pour la retraite, notamment. Dans les années 1950-1960, elles étaient autour de 15 à 18 millions.
Les données financières donnent le vertige.
Au titre des régimes de base :
- 235 Mds€ pour la maladie,
- 13 Mds€ pour les accidents du travail et maladies professionnelles,
- 288 Mds€ pour la vieillesse,17 millions d’entre nous sont retraités,
- 41 Mds€ pour la famille avec plus de 13 millions d’allocataires,
- 40 Mds€ pour l’autonomie, les situations de handicap notamment.
Au total, les prestations sociales versées par la sécurité sociale ont représenté en 2024 640 milliards d’euros, soit 22% d’un produit intérieur brut de 2 900 milliards d’euros courants. On sait aussi que le périmètre de l’ensemble de la protection sociale est plus vaste.
La sécurité sociale mérite une écologie de la pensée et de l’action.
Au titre du respect dû à nos ascendants puis à nos descendants, la sécurité sociale relève certainement d’une manière de dire et de faire et d’une écologie de l’action qui soient à la hauteur d’une telle construction et à distance de conflits idéologiques et d’algorithmes qui radicalisent, de ceux qui en font carrière et d’une vision mythologique de la création de la sécurité sociale.
Une vision stratégique tissée à travers des faits historiques
Citons le général de Gaulle (1890-1970) dans sa Déclaration aux mouvements de résistance de juin 1942, une année avant la constitution du Conseil national de la Résistance, le 27 mai 1943, à sa demande et présidée par Jean Moulin (1899-1943) : « Nous voulons que les Français puissent vivre dans la sécurité. (…) A l’intérieur, il faudra que soient réalisées, contre la tyrannie du perpétuel abus, les garanties pratiques qui assureront à chacun la liberté et la dignité dans son travail et dans son existence. La sécurité nationale et la sécurité sociale sont, pour nous, des buts impératifs et conjugués. »
On rappellera la reconnaissance juridique américaine du Social security act, signé par le président des Etats-Unis Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), le 14 août 1935. Dans le cadre du New Deal, cette sécurité sociale visait à atténuer les effets de la pauvreté chez les seniors, les chômeurs, les veuves et les enfants privés de leur père.
Le Gouvernement provisoire de la République française, sous la présidence du général de Gaulle, porte les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 organisant la sécurité sociale.
Avec d’autres bien sûr, l’histoire retient les noms d’Ambroise Croizat (1901-1951), responsable syndical à la Confédération Générale du Travail, membre du Parti Communiste Français, qui militait pour un système étatisé et radical, et celui de Pierre Laroque (1907-1997), membre du Conseil d’Etat et, en date du 5 octobre 1944, directeur général des assurances sociales auprès du ministre du Travail Alexandre Parodi (1901-1979), qui optait pour un modèle paritaire.
Ambroise Croizat a œuvré à la création des caisses locales.
Pierre Laroque a mis en place la sécurité sociale. Il a présidé la Caisse nationale de Sécurité sociale de 1953 à 1967.
Une émancipation des travailleurs.
Ces extraits de l’exposé des motifs de l’ordonnance du 4 octobre 1945 sont explicites.
« La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu’en toutes circonstances il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes.
Trouvant sa justification dans un souci élémentaire de justice sociale, elle répond à la préoccupation de débarrasser les travailleurs de l’incertitude du lendemain, de cette incertitude constante qui crée chez eux un sentiment d’infériorité et qui est la base réelle et profonde de la distinction des classes entre les possédants sûrs d’eux-mêmes et de leur avenir et les travailleurs sur qui pèse, à tout moment, la menace de la misère.
Envisagée sous cet angle, la sécurité sociale appelle l’aménagement d’une vaste organisation nationale d’entraide obligatoire qui ne peut atteindre sa pleine efficacité que si elle présente un caractère de très grande généralité à la fois quant aux personnes qu’elle englobe et quant aux risques qu’elle couvre. Le but final à atteindre est la réalisation d’un plan qui couvre l’ensemble de la population du pays contre l’ensemble des facteurs d’insécurité ; un tel résultat ne s’obtiendra qu’au prix de longues années d’efforts persévérants, mais ce qu’il est possible de faire aujourd’hui, c’est d’organiser le cadre dans lequel se réalisera progressivement ce plan (…) »
La France est appauvrie par les années de guerre et d’occupation.
L’ouverture de droits se fait d’abord autour du travail et non de la citoyenneté. Il s’agit de débarrasser les travailleurs de la hantise du lendemain. L’obligation de cotiser fonde le changement d’échelle.
A côté du régime général pour les retraites, les accidents du travail et la maladie, une hétérogénéité demeure, qu’il s’agisse de la fonction publique, des chômeurs, des professions libérales et agricoles, des cadres.
La sécurité sociale crée une assurance-maladie sans faire disparaître les mutuelles qui conservent une couverture importante des soins pour ceux qui sont couverts par l’assurance maladie et même totale pour tous ceux qui ne sont pas salariés.
La sécurité sociale est à gestion paritaire sous un contrôle étroit de l’État. Le financement du système repose sur des cotisations réparties à part égales entre salariés (4%) et employeurs (4%). L’impôt est absent.
La solidarité est d’abord professionnelle et fondée sur des cotisations sociales.
Maints obstacles ont marqué les premières années de la sécurité sociale.
Ainsi, des compromis ont été construits :
-Avec le contexte politique et géopolitique.
-Avec les médecins qui craignaient de devenir des fonctionnaires.
-Avec certaines entreprises qui refusaient de payer les premières cotisations.
-Avec les artisans et les notaires.
-Avec les mutuelles historiques.
-Avec les syndicats en conflit pour le contrôle des caisses locales.
Le général de Gaulle impose en 1946 la parité stricte entre le patronat et les syndicats.
Pendant que, pratiquement, il fallait tout construire à la main. Le bon fonctionnement de la sécurité sociale a nécessité dix ans.
En nous excusant de son caractère schématique et incomplet, le bref rappel suivant semble utile.
On peut se reporter au site https://80ans.securite-sociale.fr/
Les ordonnances ont créé le cadre. Les lois suivantes vont le remplir et l’étendre.
- Loi du 22 mai 1946. Elle généralise les allocations familiales à toute la population, indépendamment de l’activité professionnelle.
- Loi du 13 septembre 1946. Elle établit le principe du régime de retraite pour tous les salariés.
- Loi du 30 octobre 1946. Elle pose le principe de la couverture maladie pour tous les salariés.
- Création de l’UNEDIC (1958), l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, association chargée par délégation de service public de la gestion de l’assurance chômage, en coopération avec France Travail, anciennement Pôle emploi.
- Loi du 31 décembre 1971. Elle réforme les retraites complémentaires des cadres et non-cadres du privé (AGIRC, Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres, ARRCO, Association des Régimes de Retraite complémentaire).
- Loi du 2 janvier 1978. Elle Instaure la couverture maladie universelle pour les personnes âgées.
- Création de la CSG, la Contribution Sociale Généralisée, par la loi de finances pour 1991. Elle élargit l’assiette des ressources à tous les revenus (et non plus seulement au travail) et marque un glissement de la logique assurantielle (cotisations) vers une logique de solidarité nationale (impôt).
- Loi du 27 juillet 1999. Elle crée la Couverture Maladie Universelle (CMU) et achève l’ambition universaliste de 1945 en matière de santé en garantissant l’accès aux soins aux plus démunis.
- Loi du 13 août 2004. Elle crée le médecin traitant et le parcours de soins coordonnés.
- Loi du 26 janvier 2016. Elle relance le dossier médical partagé et renforce la prévention et la sécurité des soins.
Des dispositifs complétés.
L’évolution de la sécurité sociale a donc été marquée par l’intégration de compléments importants.
- En 1988, le Revenu Minimum d’Insertion (RMI, 1988-2009), remplacé en 2009 par le Revenu de Solidarité Active et en 1999 la Couverture Maladie Universelle (CMU), remplacée par la Protection Maladie Universelle (PUMA) en 2016, procèdent de la logique du filet social.
- La PUMA est la « sécu de base » pour ceux qui n’ont pas de régime de base.
- Quant à la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), remplacée par la Complémentaire Santé Solidaire (CSS, 2019), elle permet d’offrir une mutuelle à ceux qui n’en ont pas du fait de leur activité.
- Depuis 1999, l’Aide médicale de l’Etat (AME) qui relève du budget de l’Etat est la couverture maladie des étrangers en situation irrégulière.
- En 2004 apparaissent les franchises médicales et en 2016 le 100% Santé pour les soins dentaires, auditifs et l’optique.
Quelle démographie ?
Si en 1945 on comptait 4 actifs pour un retraité, ce rapport est de 1,7 actif pour un retraité en 2025.
La double transition démographique et épidémiologique, pourtant perçue de longue date par nombre d’observateurs, place la sécurité sociale face à des difficultés croissantes. Sa dette apparaît dès 1985. Vieillir en bonne santé est heureux. On ne peut cependant nier le poids croissant des affections de longue durée.
Solidarité, réformes multiples et fatigue démocratique
Si la solidarité est à l’honneur de notre pays et du choix de civilisation de 1945, selon une expression de Pierre Laroque, ce choix représente en moyenne 8 500 euros par habitant, aujourd’hui.
Mais il se peut que les complexités institutionnelles en jeu, les tensions et conflits qui s’attachent à l’expression de « réforme », notamment lorsqu’il s’agit de retraite ou d’organisation de l’offre de soins, nourrissent de la fatigue démocratique.
Un édifice juridique impressionnant.
Evoquons maintenant l’édifice juridique colossal qu’est la sécurité sociale. Nous aurons à l’esprit qu’il émane d’une longue histoire embrassant maintes générations avant les nôtres – si l’on veut bien prendre en compte les origines anciennes, locales, associatives, coopératives et mutualistes, des sociétés de secours mutuel et caisses de prévoyance, l’économie humaine réelle.
Certaines lois très importantes :
- La loi du 22 mars 1841 limite le travail des enfants.
- La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail instaure la présomption d’imputabilité et une réparation forfaitaire des accidents, rompant avec le code civil qui obligeait à prouver la faute de l’employeur. C’est l’ancêtre direct du principe assurantiel.
- Il y aura aussi la loi du 5 avril 1910 sur les « retraites ouvrières et paysannes », une première tentative, limitée et mal acceptée, de créer un système de retraite par capitalisation.
- Et les lois des 5 avril et 30 avril 1930 sur les assurances sociales. Inspirées du modèle bismarckien, elles créent un système obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès pour les salariés de l’industrie et du commerce dont le salaire est inférieur à un plafond. C’est la véritable matrice technique et administrative de la future sécurité sociale.
Aujourd’hui, le Code de la sécurité sociale réunit 2,5 millions de mots environ, sur 3 800 pages, soit quatre fois le volume du Code civil. 40% des articles portent sur la branche Maladie, 30% sur les Retraites, 30% sur les branches Famille et Accidents du travail. Outre le code rural, 15 autres codes sont concernés. De nombreux textes réglementaires sont associés. Chaque année, s’ajoutent 200 textes, lois, décrets, accords.
Le Code de la santé publique comporte 3,5 millions de mots. 120 articles encadrent le médecin traitant, au titre du parcours de soins.
L’état de droit s’essouffle
Si un souhait de simplification vient assez naturellement aux esprits épris de lisibilité démocratique et d’économie quotidienne des efforts communs, encore faut-il savoir comment y parvenir et, sans doute, devoir se mettre en position d’inventer les méthodologies adaptées à une telle ambition.
En attendant, il y a 8 000 litiges par an sur l’interprétation des seuls textes en santé. Néanmoins, diverses expressions et acronymes sont d’usage quotidien dans notre pays.
Il ne semble pas malveillant de souligner que l’Etat de droit s’essouffle dans un monde « volatil, incertain, complexe et ambigu », pour lequel il n’a pas été conçu.
Compte tenu de l’importance des mots dans nos représentations d’ensembles complexes, ce point vaut d’être abordé.
Des expressions façonnent la réalité quotidienne de la sécurité sociale.
Au titre du régime général, « Ma carte Vitale » et le numéro à 13 chiffres, « CPAM » (Caisse primaire d’assurance maladie), « feuille de soins » de plus en plus dématérialisée, « Tiers payant » et aussi « ameli.fr », le site de l’assurance maladie qui intègre « Mon espace santé », carnet de santé numérique et sécurisé, sont d’usage permanent.
Remplacé par le sigle SSI, Sécurité sociale des indépendants, en 2020, le sigle « RSI », Régime Social des Indépendants, reste dans les mémoires.
La « MSA », Mutualité Sociale Agricole, est la sécurité sociale des agriculteurs. Grâce à la loi Morice de 1947, les fonctionnaires d’État disposent d’une Sécurité sociale qui leur est propre. Ainsi, la MGEN assure la protection sociale des agents de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en assumant la gestion de leur régime obligatoire d’assurance maladie.
Retraites de base et complémentaire, Famille, Accidents du travail et Maladies professionnelles ont aussi des expressions emblématiques.
Au titre du recouvrement, « l’URSSAF », l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, collecte et gère les cotisations sociales.
Les employeurs sont tenus, mensuellement, à la déclaration sociale nominative (DSN) des sommes perçues par les salariés et au versement des cotisations et contributions sociales.
La branche Autonomie, créée en 2021, a aussi ses expressions : « la CASA » (Caisse d’Assurance de Solidarité Autonomie), « l’APA » (Allocation Personnalisée d’Autonomie) – pour les personnes âgées dépendantes, « le plan d’aide » – qui définit les besoins en accompagnement. On peut ajouter « le reste à charge » – montant payé par la personne après les aides, « l’HAD » (Hospitalisation À Domicile) – souvent liée aux prises en charge de l’autonomie, « le forfait dépendance » en EHPAD, « l’aidant familial » – reconnu et soutenu par cette branche.
N’est-il pas souhaitable que chaque futur citoyen soit en mesure de connaître ces expressions et autant que possible d’en avoir visualisé, de manière adaptée, le sens et le rôle dans leur vie présente et future et celle de notre communauté nationale ?
L’usage de certaines expressions, voire leur manipulation, n’a guère aidé aux évolutions nécessaires. On peut ainsi penser à « capitalisation ».
Si l’on pense que la théorie vient au soutien de la pratique et réciproquement, un bref rappel est sans doute utile.
Quelques fondements théoriques de notre sécurité sociale française
Histoire et Science politique
La sécurité sociale n’est pas née d’abstractions mais d’un compromis historique issu de la Libération et du programme du Conseil National de la Résistance (CNR). Il s’agissait d’éviter les conflits de classe et de construire une nouvelle légitimité républicaine sur des bases sociales solides, de « libérer l’homme de la peur du besoin », selon Pierre Laroque. Il s’agissait sans doute aussi de clore la séquence des immenses tragédies subies : 1870-1871, 1914-1918, 1939-1945.
Science économique
La France emprunte le modèle assurantiel de l’Allemand Otto von Bismarck (1815-1898), chancelier de l’Allemagne de 1871 à 1890, une protection liée au travail et financée par des cotisations sociales patronales et salariales, prélevées sur les salaires des actifs.
Elle le généralise pour tendre vers l’universalité. Des droits à protection, soins, retraite, sont acquis. C’est la dimension « Sécurité ».
Notre modèle est hybride. Il emprunte aussi à la logique de redistribution et de solidarité du Britannique William Beveridge (1879-1963), auteur du Report to the Parliament on Social Insurance and Allied Services, en 1942. Il fournit les bases de réflexion à l’instauration de l’État-providence par le gouvernement travailliste d’après-guerre. Un socle de protection minimal pour tous, indépendamment des parcours professionnels, est garanti. En France, la solidarité nationale est financée par l’impôt, la Contribution Sociale Généralisée (CSG, 1990) et les transferts entre branches. C’est la dimension « Sociale ».
La logique de Service Public prévaut. La protection n’est pas une marchandise. C’est un droit garanti par la nation, géré selon des principes d’égalité d’accès, de continuité du service et d’adaptabilité.
Le modèle français, hybride, est donc à la fois contributif et redistributif, professionnelle et universel, autrement dit généralisé.
Philosophie
Le système incarne une conception de la justice comme protection contre l’aléa (on ne choisit pas de naître pauvre, de tomber gravement malade ou de vieillir). Il s’agit de mutualiser les risques pour que le destin individuel ne dépende pas uniquement de la chance ou du mérite.
La sécurité sociale vise à garantir que chaque personne, quelle que soit sa situation, puisse vivre dans des conditions dignes (accès aux soins, revenu minimum à la vieillesse). C’est un rempart contre la misère et l’assistance ponctuelle et humiliante.
Il s’agit aussi de la mise en pratique du troisième terme de la devise républicaine : la Fraternité. Je cotise pour les malades d’aujourd’hui, les actifs de demain cotiseront pour moi : c’est un pacte entre les générations et entre les bien-portants et les malades. Ainsi, la santé et la protection sociale ne sont pas des biens de consommation ou des services marchands. Ce sont des droits ouverts aux personnes.
Epistémologie, « Comment faisons-nous ? »
La Sécurité sociale a été pensée comme globale. Tel est, à mon modeste sens, son génie. On soigne une personne en pensant à son environnement familial et à son avenir.
Naturellement, la raison statistique et actuarielle et la connaissance des risques sont nécessaires. Ensuite, la mutualisation peut fonctionner à grande échelle.
Encore faut-il calculer correctement les cotisations nécessaires pour couvrir les prestations futures. Les techniques les plus avancées et éprouvées de calcul des coûts, de mesure des gaspillages et des coûts de non-qualité ne devraient-elles pas prévaloir ?
Des aspects critiquables de l’équilibre actuel
S’agissant de la santé tout particulièrement, le mode de rémunération et la tarification des actes et activités des professionnels de santé constituent des défis de premier ordre pour la qualité des échanges démocratiques et celle des modélisations des choix possibles et de leurs conséquences respectives.
En médecine de ville, la multiplication des actes peu utiles est évidente. Faut-il alors rappeler que l’argent des médecins et l’argent des assurés est le même argent. Faut-il rappeler que cette unique profession libérale bénéficie d’une clientèle solvabilisée par un financement socialisé ?
Les consultations longues sont sacrifiées. Et donc la prévention.
La tarification à l’activité hospitalière est une usine à cases. Les soins chroniques sont sacrifiés.
Les alertes et propositions n’ont jamais été entendues, y compris celles de la Cour des comptes.
On rappellera la parcellisation extrême.
En médecine de ville, en secteur 1 (tarif de base), 4 500 actes sont codifiés, en secteur 2 (dépassements), 3 000. Il y a aussi 800 actes hors nomenclature, non remboursés. 8 300 tarifs différents !
Pour les hôpitaux publics et les établissements de santé privés d’intérêt collectif, aux 2 300 tarifs il faut en ajouter 600 au titre de la réanimation et d’actes complexes. Les cliniques privées sont l’objet de 1 500 tarifs.
Au total hospitalier, 4 400 tarifs officiels constituent un casse-tête. Un même acte peut avoir 5 tarifs différents selon le lieu où il est pratiqué.
Pendant ce temps, la prévention ne représente que 2% du budget national de santé. C’est 10% en Suède.
Gestion: Comment la sécurité sociale est-elle gérée ?
A l’origine, la gestion relevait du paritarisme, mode de gouvernance unique où la gestion est confiée aux partenaires sociaux, syndicats de salariés et d’employeurs. Le fondement épistémologique est, dans cet immense domaine comme dans d’autres, que l’intelligence du terrain puisse produire la connaissance pertinente pour gérer la Sécurité sociale, ainsi cogérée.
Pour ma modeste part, je déplore que l’on évoque si peu les 4 millions d’entrepreneurs et d’entreprises de notre pays, en comparaison de leur dynamisme, notamment chez les plus jeunes, et de leurs contributions. Encore faut-il en connaître certaines, avec précision.
En synthèse, les fondements de la Sécurité sociale française sont un assemblage unique et puissant. Politiquement, c’est le fruit du compromis de la Libération. Sur le registre économique, c’est une hybridation entre assurance professionnelle et solidarité nationale. Éthiquement, elle incarne la justice sociale, la dignité et la fraternité. Épistémologiquement, elle repose sur une gestion paritaire et une vision globale des risques sociaux, bien éloignée du « chacun pour soi ».Compte tenu de ses impacts réels et très concrets dans nos vies et pour le monde du travail, sa gestion est d’une importance fondamentale.

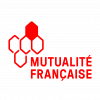



Afficher les commentaires
la FNATH, la Sécurité sociale est d’abord un projet de société
80 ans de la Sécurité sociale : pour un patriotisme social
A l’occasion de ses 80 ans, la FNATH rappelle que la Sécurité sociale est d’abord un projet de société. Construite sur les cendres d’une certaine France qui s’était laissée séduire par le repli sur soi, le racisme et l’exclusion, et finalement la collaboration avec le nazisme, la Sécurité sociale reste un des piliers d’une société démocratique moderne. C’est pourquoi, la FNATH appelle à un sursaut collectif pour pérenniser ce modèle du « vivre ensemble » à la française dans un esprit républicain.
Elle appelle à la fin d’une idéologie économique ultra libérale mortifère pour la Sécurité sociale qui lui refuse systématiquement l’allocation de nouvelles recettes alors que les besoins en santé des populations ne cessent de croitre d’années en années du fait simplement des progrès scientifiques et de la démographie.
Elle demande à ce que les ressources allouées à une protection sociale optimale soient considérées comme un investissement collectif plutôt que comme une charge sociale qui altère la rentabilité des entreprises et qu’il soit mis fin au chantage à l’emploi.
Elle demande qu’une politique de pertinence des dépenses soit réellement mise en œuvre en même temps qu’une révolution systémique dans la prévention primaire, secondaire et tertiaire soit initiée à l’abri des conflits d’intérêts, des rentes de situation, des lobbies et des pressions politiques.
Si chacun doit contribuer à la préservation de la Sécurité sociale, les usagers et les assurés sociaux ont largement contribué à payer leurs dus avec les franchises médicales et autres participations, les déremboursements, les dépassements d’honoraires, le prix des complémentaires santé, la précarisation sociale après un accident du travail ou une maladie professionnelle.
N'en déplaise mais personne ne peut interdire aux personnes de se soigner et de bénéficier des progrès scientifiques, et le prix à payer doit être partagé entre toutes les composantes de la société. Le patriotisme social c'est un choix de société pas une charge sociale.